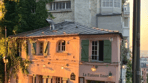L'étranger d'Ozon ou l'art de sublimer le vide
Je vous partage une page de mon journal intime retravaillé dans lequel j'ai écris mes impressions à la sortie de l'adaptation cinématographique de "l'étranger" par François Ozon.


J’ai passé le weekend dernier majoritairement en compagnie de Duras et de Camus, et de mes copines mais ce n’est pas le sujet. Aussi, je pensais que les 10H00 de pièce sur le montage de différents textes de Duras mis en scène par Julien Gosselin capturerait toute mon attention, mais c’est L’Étranger de Ozon qui me reste. Je n’ai encore lu aucune critique et je bouche très fort mes oreilles. Après la séance, C. et moi ne nous parlions pas, nous sommes restées assises un moment dans la salle sans rien dire, le flottement s’est imposé à nous. Je ne suis pas ressortie en colère comme lors du visionnage de La petite dernière de Fatima Daas réalisé par Hafsia Herzi, non, dimanche je suis sortie assez interloquée.
Pour celles et ceux qui auraient occulté leurs cours de français, voici un petit résumé : L’Étranger raconte la trajectoire de Meursault, un homme détaché du monde, dont l’indifférence face aux normes sociales, notamment lors de la mort de sa mère, le place en décalage. Un meurtre absurde sur une plage, un procès où on le juge autant pour son crime que pour son absence d’émotions. L’absurdité de l’existence, la rupture entre l’individu et le monde.
Je n’avais pas relu l’œuvre depuis dix ans. C’est long dix ans ? Je me souvenais évidemment de cette dimension absurde chère à Camus qui ne m’est pas étrangère.
En sortant du cinéma, je repensais à cette phrase que Meursault répète comme un refrain : « je ne sais pas ». On lui propose une chose ou son contraire, il « ne sait pas », ou cela lui est égal, c’est « sans importance ». Épouser Marie ? Sans importance. Regarder une dernière fois sa mère ? À quoi cela servirait-il ? Tuer l’Arabe ? Le hasard.
Marie lui dit : « tu es bizarre, différent des autres ». C’est comme si cet homme était inhabité. Il peut se montrer serviable, ne pas faire de vague, travailler sérieusement mais sans ambition. Lorsque son supérieur lui propose une promotion à Paris, il répond : « Cette vie ici ne me déplaît pas, pourquoi une autre plutôt que celle-ci ? ». Tout est au même niveau, rien n’a de poids.
 L’étranger adapté par François Ozon, 2025, Gaumont
L’étranger adapté par François Ozon, 2025, Gaumont
Toutefois, c’est un homme, en tout cas dans le film, qui ne semble pas déconnecté de la dimension sensuelle du monde : il prend plaisir à faire l’amour, à se rendre aux bains, à rester à la plage, à se nourrir de la lumière. Il n’y a pas de logique ou d’incarnation dans son appréhension du monde et de ses émotions mais il sait trouver une forme “d’harmonie” temporaire avec la nature. Et c’est cette même nature qui le révèlera à la “vérité” de son existence. Je m’explique : la lumière du soleil qui se reflète sur le couteau de “l’arabe”, qui aveugle Meursault, et le fait tirer la première fois est énigmatique. Au tribunal quand on lui demandera “pourquoi avez-vous tué ?” il répondra “ à cause du soleil,” et personne ne le comprendra au contraire on rira de sa réponse. Mon interprétation, c’est que ce reflet contient une charge importante, comme une charge symbolique de la nature qui aveuglerait Meursault. Lui, l’homme jusque là à distance du monde, l’homme qui ne “sait pas”, l’homme pour qui tout est “sans importance,” le voilà aveuglé par le soleil depuis la main d’un indigène, de cet autre diamétralement opposé. On pourrait croire que “l’arabe” est cet étranger, ou que l’étranger renvoie à l’étrangeté du protagoniste face aux normes sociales, mais pour moi “l’étranger”, c’est ce que Meursault est à lui même jusqu’au moment où il tue “l’arabe”. A partir de ce moment, l’existence cesse de devenir aussi absurde car elle possède un poids, le poids de la vérité de son acte, maintenant “il sait”. Et une deuxième vérité viendra donner du relief à son existence : l’approche de sa propre mort.
Il le dit lui-même à l’aumônier :
« Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides. Mais j'étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela. Mais du moins, je tenais cette vérité autant qu’elle me tenait. »
En clair, mon interprétation diverge de celles que l’on lit habituellement : le meurtre ne serait pas la preuve ultime de l’absurde, mais l’instant où Meursault cesse d’être étranger à lui-même.
Le moment où l’acte, violent, irréversible, lui donne un poids, le projette dans une vérité qu’il ne peut plus esquiver. La nature, par son intensité, par cette lumière insoutenable, l’aurait accouché en tant que « sujet ».
Quelque chose éclot en lui au moment même où il ôte la vie à Moussa.
Et voilà, c’est là le problème ! Le problème de Camus dans l’œuvre, et le problème qu’Ozon ne résout pas. Car si l’on adopte cette lecture, Meursault comme sujet enfin révélé par le meurtre, alors on tombe dans un piège : on finit par éprouver une forme de soulagement pour lui. Une empathie. Une compréhension qui, par ricochet, allège le poids du meurtre de Moussa. Car Moussa, même nommé, même un peu filmé, demeure le passage obligé, l’objet par lequel Meursault accède à lui-même. L’humanité de l’un se reconstruit sur la mort de l’autre.
Ozon tente d’ajouter des éléments, le nom de “Moussa Hamdani” emprunté à Kamel Daoud, une sœur qui parle, une esquisse de contexte colonial, mais cela reste insuffisant. Car aujourd’hui, « l’Arabe » n’est plus un signifiant neutre. On ne peut plus l’entendre comme Camus l’avait écrit, comme on aurait dit « l’épicier ». Non. « L’Arabe » est une identité chargée, riche, blessée, disputée, résonnante. Et si l’on continue à raconter L’Étranger sans tenir compte de cette charge-là, alors on perpétue l’absurde colonial en arrière-plan. Un arrière-plan trop encombré, trop brûlant, pour rester décoratif.
Melinda Lefgoun Alqamar